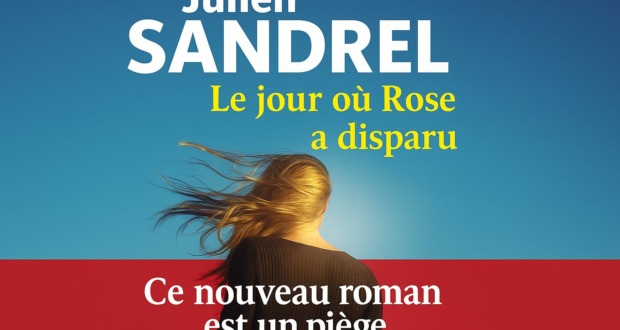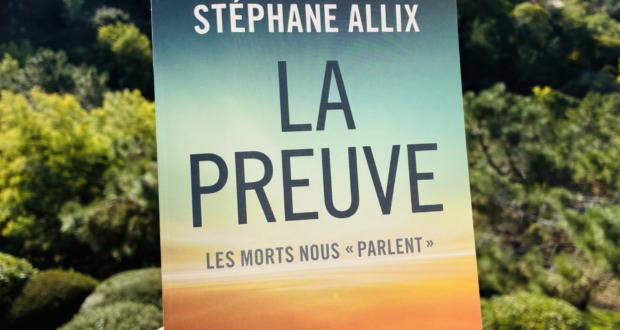Comme le stress est le mal du siècle, la crise économique justifie à elle seule toutes les dérives des employeurs. Regard sur un métier sinistré… le mien !
Je suis journaliste, victime en première ligne des professions dites sinistrées. Les offres d’emploi se font rares et ceux qui se risquent à en publier précisent lorsque le « job » est rémunéré ; voilà qui en dit long sur la nouvelle norme de ce métier : un bénévolat déguisé derrière une vitrine médiatique, offrant une pseudo-reconnaissance mirifique.
Lorsque par bonheur on vous propose de vous payer les lignes que vous aurez daigné écrire, la fiche de paye est obsolète ; il faut facturer sous peine d’être rejeté, même si ce modus operandi flirte avec l’illégalité. Le journaliste n’a d’autre choix que de se résigner à pointer aux assedics, ou opter pour le statut d’autoentrepreneur, annihilant toutes ses chances de conserver une carte de presse « collector ». Vient ensuite la négociation d’un prix au feuillet au rabais, puis le combat avec un Pôle Emploi sous qualifié pour vous aider.
Faut-il tout abandonner ou trouver un moyen de subsister dans un métier dépassé ? Les journalistes d’aujourd’hui doivent se réinventer, écrivant sur des sites potentiellement rétribués par des annonceurs séduit par leur visibilité ; encore faut-il se démarquer et accepter de « communiquer » plutôt que d’enquêter avec impartialité. Ce courant se fait bien sur au détriment de la qualité des papiers, renforçant le nivellement par le bas des rédacteurs maltraités.
De mon côté, je ne suis pas prête à renoncer à ma passion, avec pour motivation la reconnaissance d’un public sensible à mes écrits. Vivre ou survivre de sa plume, le prix de la liberté reste cher à payer !